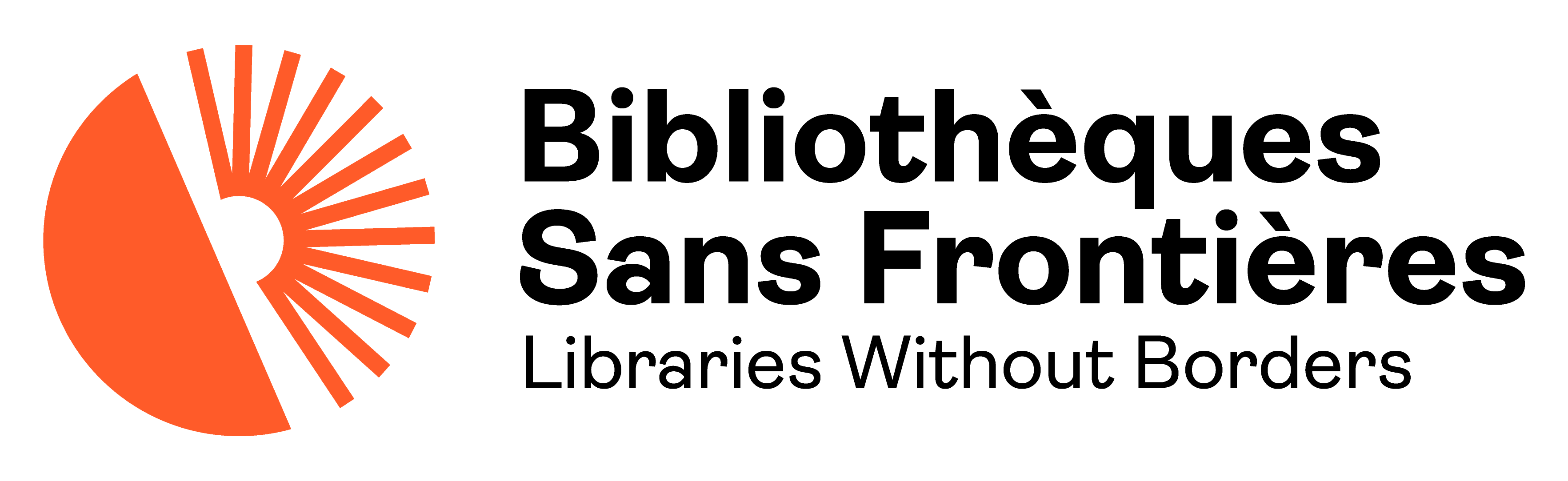Imaginez-le, dans son pantalon bleu nuit qu’il porte pour la première fois. Ses baskets blanches, encore trop propres, et son pull fin dont les manches relevées laissent entrevoir les mots de la chanteuse folk américaine Joni Mitchell. Un air de Jude Law, on lui dit souvent. Le regard clair, ni coiffé ni rasé, il pourrait être à la fois le châtelain d’un roman britannique du XIXe siècle ou le livreur de macédoine de la dernière BD de Fabcaro.
Coup de boomerang pour Augustin Trapenard, nouveau parrain de Bibliothèques Sans Frontières : l’intervieweur devient l’interviewé !
Ton premier souvenir de bibliothèque ?
Il y a d’abord celle dans le salon de mes grands-parents, en Auvergne. C’était une pièce absolument magique, entièrement recouverte de livres. Aucun mur n’était apparent, sinon de couvertures de romans. Chaque livre avait non seulement été lu, mais commenté avec une pastille : rouge pour les livres que mon grand-père n’aimait pas, verte pour ceux qu’il aimait, bleue pour ceux qu’il voulait relire. Ensuite, il y a la bibliothèque du collège Pasteur de La-Celle-Saint-Cloud. Enfin, la première bibliothèque publique qui me vient à l’esprit, c’est celle de Sainte-Geneviève, à Paris, immense, sublime, où je travaillais presque tous les soirs lorsque j’étais en Hypokhâgne et en Khâgne.
Et puis il y a ta bibliothèque personnelle.
La plus belle façon de connaître quelqu’un est de regarder les livres qu’il a chez lui. Je m’inquiète toujours d’un appartement sans livre, non parce que je juge celui ou celle qui n’a pas de livre mais parce que c’est comme si il ou elle se cachait. Les livres sont autant de miroirs et d’indices dans ce grand roman policier qu’est la rencontre avec l’autre. J’ai l’impression de dire et de donner beaucoup de moi à travers ma bibliothèque, elle m’évite souvent de devoir raconter certaines choses. Et chacun de nous porte aussi en lui ou en elle une bibliothèque intérieure, de Mimi Cracra à La recherche du temps perdu, avec laquelle on marche, on avance, on évolue, on vit. Et que l’on ne cesse de citer, même inconsciemment.
La littérature a toujours été pour moi un modèle d’intelligibilité de la vie. C’est grâce aux livres que j’ai réussi à voir le monde, à le penser et à le comprendre. Je serais par exemple incapable de parler de la question des réfugiés si je n’avais pas lu Marie NDiaye, Jean-Marie Gustave Le Clézio ou Laurent Gaudé. Je trouve qu’il n’y a rien de plus beau que les couvertures de livres lus. Chaque livre qu’on lit est inscrit en nous. Il est quelque part un peu poreux et finit par appartenir à ta propre peau.
Raison pour laquelle tu as tatoué plusieurs textes sur la tienne ?
Dans ma famille, on souffre de la maladie d’Alzheimer : ma hantise est d’oublier les mots. Voilà pourquoi j’aurai toujours sur moi ceux que je n’ai pas envie d’oublier. Ils sont issus de la littérature, de Fitzgerald et de Faulkner, mais également de la chanson « A case of you » de l’artiste folk américaine Joni Mitchell, sur le bras. La littérature est partout. Il est très important de ne pas la réduire au livre, qui peut par ailleurs faire peur. Chaque écrit participe de ce qu’est l’acte littéraire. Je me suis par exemple réjoui du Prix Nobel de littérature à Bob Dylan.
La prochaine citation ?
Je ne me suis pas encore fait tatouer sur le corps un très beau passage du roman Les Hauts de Hurlevent de la romancière britannique Emily Brontë, où l’héroïne Catherine raconte un rêve où elle est rejetée du Paradis. « Le ciel ne m’avait jamais paru être un asile fait pour moi ; j’avais le cœur brisé, je pleurais pour redescendre sur la terre, et les anges furieux, me jetaient au milieu des bruyères sur le toit de Hurlevent. » J’aime ce refus de toute idée transcendantale de paradis ou d’enfer pour lui préférer la vie, la terre. J’ai lu ce livre une trentaine de fois, il est pour moi fondateur : à sa lecture, je me suis rendu compte que la littérature était un art à la fois du langage, de la narration et de la vie.
« La plus belle façon de connaître quelqu’un est de regarder les livres qu’il a chez lui. »